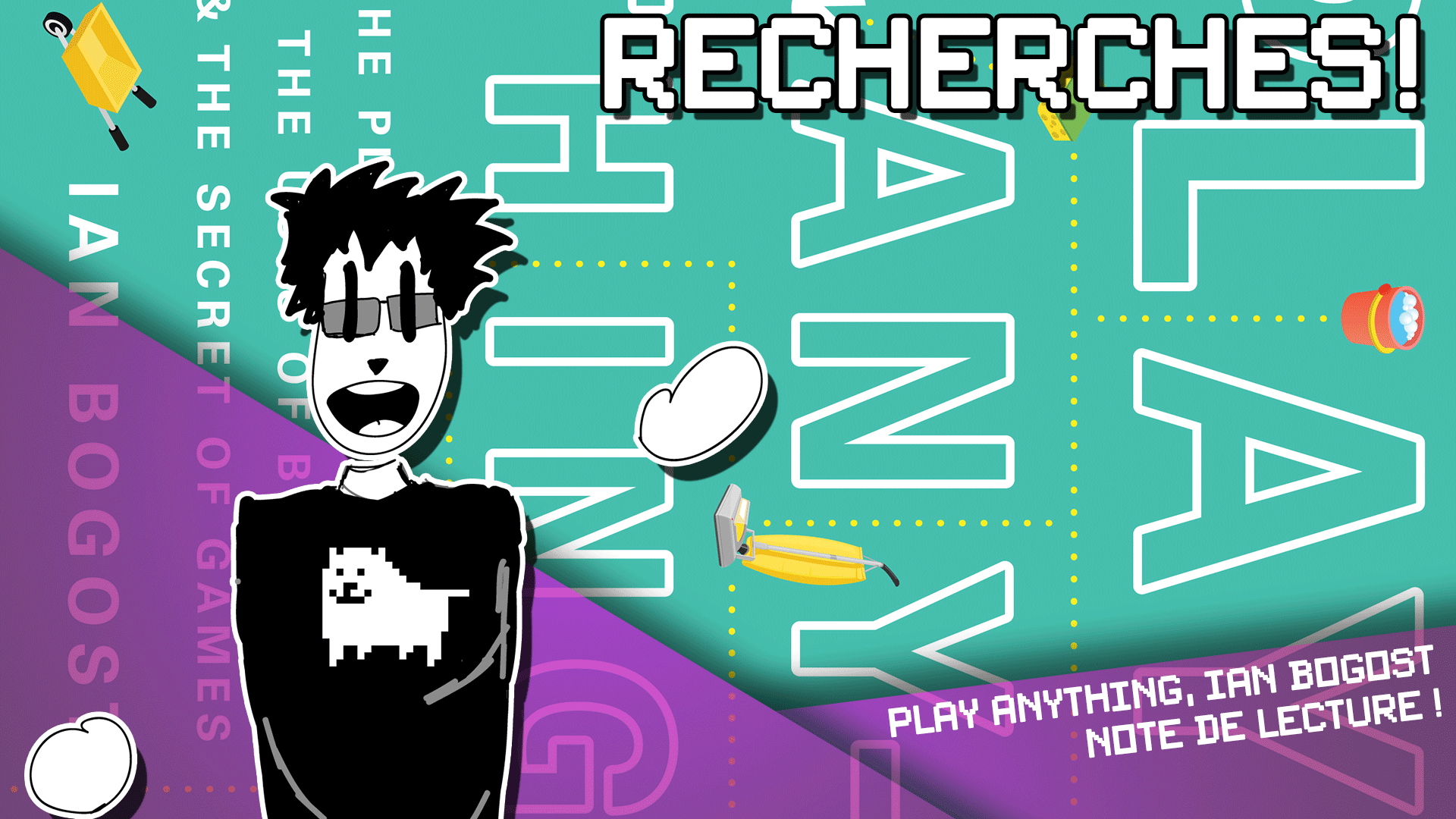J’ai lu le dernier livre de Ian Bogost et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas essayer de vous partager ce que j’en ai retenu ? Play anything n’est pas un livre sur le jeu ou sur le jeu vidéo. Bogost a déjà écrit ce qu’il avait à dire sur le sujet. Non. Play Anything, c’est un essai philosophique sur comment appréhender la vie de manière générale.
Ce livre n’a pas pour objectif d’être exhaustif dans ses sources, ni même scientifique dans son contenu. On pourrait alors critiquer cette démarche qui se veut plus sensorielle et personnelle que factuelle et rigoureuse. Et pourtant, j’ai beaucoup aimé ce livre et les propos qui y sont tenus mais peut-être que pour expliquer cela, je dois vous parler un peu de moi.
J’ai une certaine tendance à visualiser tout ce qui m’entoure sous la forme de jeux respectant des mécaniques ludiques. La loi, les relations sociales et les comportements des individus respectent pour moi des règles de jeux. C’est très loin d’une représentation parfaite du monde, je vous le concède. Pourtant, c’est celle que j’ai choisi et qui me convient le mieux aujourd’hui pour appréhender l’univers et ses règles.
Tout commence par un Terrain de Jeu
Alors, je ne dis pas que l’univers est un jeu, et Bogost ne serait pas d’accord avec cette idée non plus. Au contraire, pour lui la réalité n’a pas à être définie comme un jeu. Cependant, elle contient ce qu’il appelle des situations pouvant devenir des terrains de jeux. Et potentiellement, tout peut être propice au jeu. Là, il fait référence au concept de jouabilité d’un chose. Plus une situation possède une jouabilité élevé et plus il est possible de mettre en place un jeu à l’intérieur de celle-ci. Bogost nous dit que la plupart des situations de la vie sont jouables : se balader dans un magasin, aller au cinéma, se promener dans la rue, faire la vaisselle, le ménage. Toutes ces situations sont propices à la mises en place de ce qu’il appelle un “terrain de jeu”. Même s’il n’évoque pas le concept de Ludification au sens de Raessens. Nous pourrions y voir une critique, cependant, il convient dès à présent de dire que le concept de ludification est un concept anthropocentriste : c’est-à-dire que c’est de l’humain qui est ) l’origine des terrains de jeu . Or, Bogost, comme nous l’apprenons plus tard dans le texte, propose une vision de excentrée : les terrains de jeu proviennent des objets eux-mêmes selon Bogost. Le concept de ludification ne fait donc pas sens dans l’ouvrage de Bogost.
Et contrairement à de nombreux chercheurs qui le précédent (Huizinga entre autres), Bogost rejette l’idée que le jeu est une forme d’échappatoire, qu’il serait distinct de la réalité. Au contraire, la mise en place de “terrains de jeu”, c’est-à-dire un espace plus ou moins définis dans lequel le jeu se produit, nécessite selon Bogost précisément d’accepter la réalité telle qu’elle se présente à nos yeux. Et pour ce faire, il est nécessaire d’observer les choses qui nous entourent et de reconnaître leur existence sans jugement de valeur. En effet, Bogost nous pose une question très simple au début de son livre : pourquoi les enfants arrivent toujours à inventer des jeux dans n’importe quelle situation ? L’on peut penser aux enfant qui dans un magasin cherche à ne marcher que sur certaines dalles du sols par exemple. Bogost demande au lecteur pourquoi les adultes ne font pas la même chose ? Selon lui, les adultes observent et acceptent moins les objets qui les entourent. Or, en reprenant Don Norman, Bogost pose l’hypothèse que c’est en observant et en acceptant les choses que l’on peut voir leurs affordances, c’est à dire l’ensemble des possibilités qu’elles offrent.
L’Ironie : l’ennemie du Jeu
Et si en tant qu’adultes, nous ne voyons plus les affordances des objets et des choses qui nous entourent, c’est, selon Bogost, à cause de l’ironie dont nous faisons preuve la plupart du temps. Il définit l’Ironie comme une stratégie de distanciation. Nous faisons preuve d’Ironie au sens de Moquerie comme d’une forme d’autodéfense. L’objectif est alors de pouvoir rapidement se protéger lorsqu’un objet nous fait défaut. Il énonce alors que nous souffrons de ce qu’il appelle l’Ironoïa : la peur des choses. Cette ironoïa doit se comprendre comme une forme de paranoïa dirigée vers les objets. Mais ce n’est pas tout. L’ironoïa est aussi paradoxale dans le sens où c’est aussi une méthode pour garder les objets qui nous entoure à une certaine proximité. Ainsi, nous gardons les choses, les phénomènes à proximité mais sommes prêts à nous en distancer au moindre problème qui pourrait survenir. Par ailleurs, Bogost rapproche beaucoup l’Ironoia du sentiment de nostalgie : cet idéal inatteignable nous obligeant à limiter ce que nous pouvons attendre des choses puisque de toute façon, nous serons déçus. Dès lors, notre ironie nous empêche de pouvoir voir la jouabilité des situations. C’est pourquoi Bogost critique cette posture puisque c’est ce qui celui-lui nous empêche de jouer.
Pourtant, malgré notre inhérence à être ironique, cela ne nous empêche pas de rechercher l’amusement lorsque l’on joue. Mais Bogost questionne véritablement notre capacité à définir ce qui est l’amusement, ce qui est fun. En effet, on utilise l’adjectif “fun” pour caractériser un bon jeu vidéo. Mais ici, nous utilisons “fun” comme si nous utilisions l’adjectif “bon” pour un livre ou un film. De même, nous associons l’idée d’amusement à l’idée de plaisir mais Bogost confronte cette hypothèse à la réalité. Le constat qu’il propose serait même plutôt l’inverse. A partir d’une série non exhaustive d’exemples, il énonce que les situations mémorables et celles durant lesquelles nous nous sommes le plus amusés ne sont pas forcément liés aux situations pendant lesquelles nous avons été les plus heureux.
Définir l’amusement par la nouveauté
De même, ce n’est pas quand nous nous sentons en équilibre dans une situation que nous nous amusons, au contraire, nous serions plutôt dans un état proche de l’ennui. Bogost en profite également pour critiquer ouvertement l’association d’idées entre l’amusement et la théorie du flow. En effet, la théorie du flow énonce qu’il existerait une zone intermédiaire entre facilité et difficulté dans laquelle les individus sont totalement en phase avec l’activité qu’ils sont en train de réaliser. Dès lors, habituellement, cette zone est vue comme l’espace dans lequel les individus peuvent s’amuser. Or, Bogost critique ouvertement cela en expliquant qu’au contraire, la théorie du flow ne nous pousse pas à découvrir et à sortir de notre zone de confort, même si la difficulté augmente par rapport à ce que nous avons connu, celle-ci se retrouve toujours équivalente à ce que nous pouvons réaliser.
Ainsi donc, pour Bogost, la recherche de l’amusement ne correspond pas à la recherche du plaisir mais plutôt la recherche de ce qui sera mémorable. Autrement formulé, le fun est fortement lié à la recherche de la nouveauté. Et découvrir la nouveauté n’est possible qu’en observant les choses et le monde sans faire preuve d’ironie. Il est nécessaire d’accepter les choses telles qu’elles sont afin de pouvoir voir la nouveauté, symbolisée par la découverte de nouvelles affordances. S’amuser, c’est donc chercher de nouvelles applications aux choses qui nous entourent. Et pour cela, il faut savoir poser son regard sans jugement. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le mot “fun” anglophone provient de “Fool”. Ce personnage est lui aussi pertinent puisqu’au moyen-âge, le fou avait le rôle d’observer et de proposer des interprétations afin d’épauler les décideurs dans leurs choix. C’est en adoptant la posture du Fou que nous pouvons voir ce qui nous entoure sous la forme de terrain de jeu. Bogost nous dit qu’il suffit d’accepter la réalité telle qu’elle sans ironie et avec humilité pour comprendre que de nombreuses situations sont jouables.
C’est l’objet qui est ludique, l’humain n’a rien à voir avec cela.
Ces derniers propos sont aussi révélateurs de ce que que pense Bogost de ses prédécesseurs. En effet, pendant les premiers chapitres, il décrit un être humain qui n’est pas forcément par nature joueur, dans le sens où l’attitude ludique si chère à de nombreux chercheurs, est en fait quelque chose de bien plus complexe qu’il n’y paraît. Dès lors, Bogost fait le postulat que l’attitude ludique est bien plus contextuelle qu’intrinsèque. En effet, plutôt que de voir l’humain comme étant le point de départ d’un acte de jeu, il propose d’orienter la discussion vers les objets. C’est dans ces derniers que se trouve le jeu et non dans les Femmes et Hommes. C’est donc un objet quel qu’il soit qui possède le caractère (l’attitude ?) ludique, caractère attribué à l’humain par Huizinga et tous les chercheurs s’en inspirant.
Bogost propose de rompre avec la tradition mais il est évident que cette remarque peut très facilement s’inscrire dans une démarche constructiviste. De même, il ne s’agit finalement que de réencastrer l’acte de Jeu dans un contexte fait de relations sociales et dans un milieu précis. Ainsi, si les propos de Bogost sont pertinents, il ne sont ne sont pas novateurs. Ils cristallisent cependant dans la recherche anglosaxonne des propos qui ont déjà été abordés dans la recherche francophone (lorsque l’on parle de la nécessaire prise en compte du contexte de jeu et la mise en exergue des relations entre les agents de l’acte de jeu).
Cependant, outre cette critique que nous venons de lui adresser, il convient de faire remarquer notre sympathie pour les propos tenus. De même, la définition de “jouer” proposé par Bogost est relativement pertinente. En effet, il définit l’acte de jouer comme “The work of processing something”, ce qui donne en français moyen : “l’acte de manipuler quelque chose”. Si cette définition semble naïve, il convient de prendre en compte tous les propos précédemment tenus par Bogost. En effet, selon l’auteur, pour jouer, il est nécessaire d’observer sans ironie le monde et les objets qui nous entourent. Autrement dit, cette définition indique que jouer signifie “découvrir les affordances d’un objet”. Encore une fois, il est nécessaire de rappeler que l’amusement se trouve dans la découverte de la nouveauté selon Bogost et cette découverte n’est rendue possible qu’en exploitant, qu’en manipulant sans ironie les objets qui nous entourent.
Pour parler du Jeu, il faut parler des Contraintes
Dès lors, avec tout ce qui vient d’être dit, nous pourrions supposer qu’il est très facile de s’amuser puisqu’il ne suffit finalement que d’observer et de manipuler. Or, Bogost prend le contrepied de cette hypothèse. Cependant, encore une fois, ses propos ne sont en rien novateurs. Bogost énonce que c’est sous la contrainte que le “jeu” peut naître. Pour soutenir son propos, il part de la création artistique et énonce que si l’artiste est totalement libre de créer ce qu’il veut, il risque de ne finalement rien créer. Or c’est en s’infligeant des contraintes techniques, matériels ou comportementales que l’artiste peut créer des oeuvres d’Art. Nous retrouvons ici un postulat relativement classique dans l’Histoire de l’Art, en esthétique et dans la recherche sur le Jeu puisque les premiers travaux de Huizinga énonçaient déjà que les jeux nécessitent l’installation de contraintes. Ces contraintes prennent la forme de règles du jeu plus ou moins permissives.
Ainsi, plus on va se fixer de contraintes et plus nous aurons de facilités à adopter une attitude ludique. Cependant, Bogost critique la vision anthropocentriste des précédents penseurs ayant travaillé sur cette notion. Ici, l’une des faiblesses de Bogost est qu’il se repose principalement sur les apports de Huizinga, qui datent de 1936, or de nombreux penseurs ont retravaillé cette notion, Henriot (1969 et 1989, faisant de lui un précurseur avant Caillois) entre autres. Ainsi plutôt que d’énoncer que le jeu provient des êtres vivants, il énonce contrairement à cela qu’il provient originellement des objets entourant les êtres vivants. Ainsi, reformulé, nous jouons non pas sur notre propre initiative mais parce que ce sont les objets eux-mêmes qui possède dans une certaine mesure une ou des affordances propices à l’apparition de terrains de jeu. L’être humain quand à lui doit se défaire de son ironie, de son ironoïa, afin de pouvoir observer et comprendre les applications ludiques, déjà présentes intrinsèquement, des objets. Finalement, “jouer” pour Bogost, c’est discerner le(s) sens ludique(s) que peuvent avoir des objets et qui existent déjà. Il n’est donc pas question d’inventer des jeux mais plutôt de les découvrir. Enfin, Bogost conclut cette partie sur la nécessité de respecter les objets pour ce qu’ils sont. Il s’agit ici d’appuyer son propos sur l’origine des jeux. Ceux-ci proviennent d’abord des objets et ce sont ensuite les humains qui les “découvrent”.
Conclusion de l’ouvrage
Ainsi donc, comme nous avons pu le montrer lors de notre note de lecture, “Play Anything” soutient la thèse suivante : ce sont les objets et l’environnement eux-mêmes qui contiennent ce que Bogost nomme les “terrains de jeu”. Ce n’est donc pas l’humain qui donne un sens ludique aux choses qui l’entourent mais c’est celui qui découvre ce sens intrinsèque aux objets, à condition de s’être défait de son ironoïa, de sa peur des objets.
L’ouvrage de Bogost, comme énoncé, ne propose pas une réflexion particulière sur les jeux vidéo ou sur les jeux. Au contraire, il s’agit plutôt d’un essai philosophique sur notre conception du jeu et de comment jouer avec/dans la vie de tous les jours. Contrairement à ce qui a pu être ébauché en philosophie ou dans la recherche par le passé, Bogost choisit de détourner son regard de l’être humain (ou tout être vivant) pour valoriser les objets et l’environnement. L’intérêt de cette démarche est bien entendu de se défaire d’une vision anthropocentriste du jeu en considérant que le ludique fait partie intrinsèquement des objets. Pour Bogost, c’est aussi une façon proposer une vision plus humble de ce qu’est le jeu et ce pour deux raisons. Premièrement, ôter cette caractéristique de l’être humain permet de minimiser l’importance de son rôle dans l’acte de jouer tout en revalorisant les objets (les structures de jeu) et secondement, comme il énonce au début de sa réflexion, “jouer” nécessite d’observer le monde qui nous entoure tel qu’il l’est et de l’accepter. Bogost nous dit clairement qu’il faut “embrasser le monde qui nous entoure”, que jouer, c’est « faire ce que l’on veut avec les choses qui nous sont données ».
Discussions, limites et ouvertures
Cependant, plusieurs limites se font sentir dans cette réflexion. Premièrement, il nous aurait semblé plus pertinent de s’intéresser de manière plus approfondie aux relations entre les objets et les joueurs. En effet, à force de vouloir mettre en avant les objets et le contexte, Bogost formule non pas une représentation fondamentalement différente de ce qu’est le jeu mais simplement une inversion des rôles. Cependant, force est d’admettre que l’idée d’associer la caractéristique du jeu directement à l’objet est séduisante mais cela suscite de nouvelles questions que Bogost n’aborde pas. En effet, il place l’humain en tant que “découvreur” du sens ludique préexistant mais nous pouvons interroger dans quelle mesure celui-ci peut prétendre à ce rôle. Selon Bogost, il suffit de se défaire de son ironie afin d’observer le monde à sa juste valeur, cependant, des travaux comme ceux de José P. Zagal (2010) ont déjà approfondi cette piste de recherche en questionnant la littératie vidéoludique des individus. Dès lors, bien que les travaux de ces deux auteurs ne soient pas exclusifs, il convient de s’interroger sur les similitudes et les réponses qu’ils proposent.
De même, dans la réflexion de Bogost, le contexte historique et sociologique des individus n’est que très peu abordé or d’autres chercheurs (Henriot, Genvo entre autres) ont déjà noté l’importance de la prise en compte de ce contexte pragmatique dans la mise en place d’une situation de jeu : ce qui est jeu dans un contexte historique et géographique ne l’est pas forcément dans un autre. De même, malgré les revendication d’humilité de Bogost, la thèse du livre se repose beaucoup trop sur une vision individualiste. Proposer des axes de recherches à un niveau macro socioculturel aurait été pertinent. Par exemple, nous pourrions nous demander dans quelle mesure le regarde de l’Autre impacte la mise en place d’un terrain de jeu ? Comment un jeu est socialement validé ou critiqué ? Pour reprendre Bogost, il suffirait d’énoncer que tout cela se regroupe dans ce qu’il appelle les contraintes nécessaires à l’apparition du jeu mais afin de poursuivre cette réflexion, il conviendrait de s’interroger sur la part que chacune des contraintes peut avoir sur les terrains de jeu.
Par ailleurs, il convient de remarquer qu’à un moment dans l’ouvrage, Bogost critique la théorie du Flow de Mihaly Csikszentmihalyi en énonçant que finalement, si l’on cherche toujours à rester dans une certaine zone de confort, cela ne correspond pas à la définition de Bogost de l’amusement. Bogost accuse à raison la théorie du Flow d’un certain conservatisme. Cependant, la conclusion de Bogost ne propose finalement pas non plus de s’émanciper d’un certain « statu quo » avec l’environnement dans lequel on se trouve. Bien que l’on pourrait argumenter que sa proposition permet efficacement de justifier les processus d’innovations (l’on pourrait d’ailleurs s’amuser à tisser des liens entre la pensée de Bogost et celle de Schumpeter à propos de l’entrepreneur), cela ne s’appliquerait pas forcément dans des situations critiques comme celle d’une dictature. En effet, l’une des limites de la thèse de « Play Anything » est que le jeu n’émerge que de situations et de règles préexistantes au joueur, or cette réflexion ne prend pas en compte de manière détaillée et constatable les changements de règles formalisés par exemple par des changements de paradigmes scientifiques (l’apparition d’une nouvelle théorie) ou politiques (les révolutions sont justement le renversement d’un système de règles). ■
Esteban Grine, 2016
(modifié le 18/10/2016, ajout d’un paragraphe dans la partie « discussions, limites et ouvertures »)